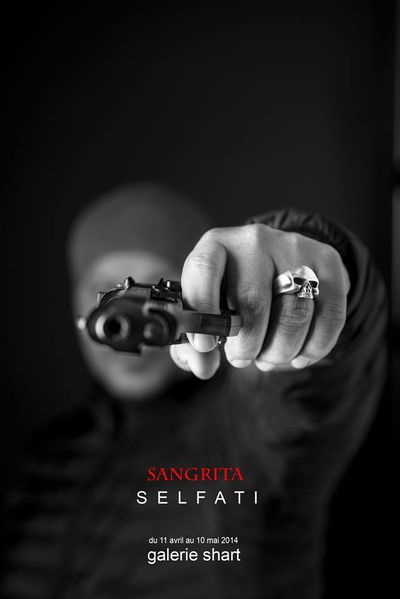Prospero : Nous sommes de la même étoffe que les songes, et notre vie infime est cernée de brouillard…
(Prospero : We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep)
La tempête (The Tempest) – Acte IV, scène 1, 1611, William Shakespeare (trad. Pierre Levris, Ed. Flammarion, Coll. Garnier Flammarion/théâtre bilingue, 1993
« Si j’avais bien dormi toujours, j’aurais jamais écrit une ligne ». Cette phrase de Louis-Ferdinand Céline, qu’il a écrite dans Mort à crédit, exprime un certain fantasme, sinon un mythe, de la création artistique. Tandis que le commun des mortels est plongé dans le sommeil, alors que partout l’activité et la production humaine se sont ralenties, l’artiste, lui, dans le silence et la solitude de la nuit, œuvre. La nuit serait le moment privilégié de la création, et finalement, bienheureux les artistes privés de sommeil. L’insomnie, compagne et muse des artistes ? L’insomnie, bienfaitrice des arts : une conception romantique, peut-être, d’un artiste si fiévreux et si tourmenté par ce dont il doit accoucher, tant appelé par l’inspiration, qu’il n’en trouve pas le repos. Bien sûr, nombreux sont les artistes, écrivains, penseurs (Kafka, Musset, Hugo, mais aussi Louise Bourgeois et ses 250 « Insomnia Drawings » par exemple), à trouver dans le temps suspendu des nuits rétives au sommeil l’espace idéal pour se raconter des histoires, nourrir ou vaincre ses obsessions, ses angoisses ou ses démons, les coucher sur le papier ou la toile. Au risque du sommeil, des cauchemars, des visions terrifiantes, à la « sensation du gouffre », pour reprendre l’expression de Baudelaire[1], certains préfèreront toujours la lucidité, même fatiguée, de la veille.
Mais si, en réalité, le sommeil et les rêves étaient les plus fertiles des terreaux créatifs l? Si dans les arcanes des rêves se cachaient justement la substance même de la création artistique ?
D’abord parce que c’est parfois dans leurs visions oniriques que les artistes puisent leurs intuitions les plus profondes, les images, les représentations qu’ils tenteront de redessiner plus tard, comme le fit Edouard Levé et ses « Rêves reconstitués » (Photographies, 1998). L’artiste raconte : « Je faisais peu de rêves, ou alors je m'en souvenais mal. Un jour, au réveil, un rêve m'est apparu très clairement sous la forme d'un fragment, c'est à dire une image arrêtée, et non sous celle d'un film avec un début et une fin. Ce fragment était porteur d'une étrangeté bienfaisante. Y repenser me ravissait. J'ai cherché comment me souvenir de ce rêve, et le réactiver quand je le voudrais. Je l'ai noté, puis je l'ai dessiné. Mais ça ne suffisait pas: la description et le dessin étaient éloignés de l'image dont je me souvenais, et je craignais qu'elle ne s'estompe avec le temps. J'ai alors pensé à photographier ce rêve pour le figer définitivement.»[2]
Ensuite parce que les rêves recèlent de suffisamment de mystère, d’absurdité, de poésie, de beauté ou d’effroi pour nourrir n’importe quel esprit en quête de produire une œuvre au plus près de soi. Plonger dans le sommeil c’est plonger en soi-même comme en un territoire inconnu, dont l’esprit fantasque de l’artiste ne saurait qu’être avide. Tout un monde, un autre monde, à sa portée, chaque nuit, un réservoir inépuisable d’inspiration, de sens et de non-sens.
Enfin, parce que le processus même à l’œuvre dans la création artistique, que son contenu ou son sujet s’inscrive ou non dans un lien direct avec le rêve, partage sans doute avec lui une filiation, dans son élaboration plus ou moins consciente –vision, mais aussi, association d’images et d’idées, glissement, condensation, langage, décalage -.
Telle est sans doute une des raisons pour laquelle les univers oniriques inspirent tant les artistes toutes disciplines confondues et dans toute l’histoire des arts.
« La nuit pendant que vous dormez je détruis le monde », a écrit Claude Lévêque (néon blanc, 2007), s’inspirant d’une phrase qu’aurait prononcé le criminel Charles Manson. A cette noire assertion, nous avons préféré son « Rêvez ! » (Néon coloré, 2008), injonction polysémique, selon que l’on soit naïf ou lucide, idéaliste ou résigné…S’agit-il d’une invitation à l’espoir (« Il faut continuer de rêver »), d’une ironie (« Vous pouvez toujours rêver… »), d’un appel à l’action (« Réalisez vos rêves ! ») ? Rêver ? A l’ère des mortes utopies, voici un souci plus que jamais contemporain !
D’une manière ou d’une autre, l’exposition « Au-delà de mes rêves », au travers de plus de 100 œuvres de près de 60 artistes, montre ainsi à quel point le rêve –et ses « dérivés », de la rêverie à l’utopie, de la méditation à la poésie- reste un thème privilégié dans l’art aujourd’hui, et entend bien démontrer combien les domaines du sommeil et du rêve recèlent en effet de richesses propres à garder en éveil la créativité des artistes contemporains.
Pourtant, on objectera à l’inventivité des artistes qu’il n’y a rien de plus universel, et de plus banal, de plus évident, et de plus ordinaire que le sommeil, et les rêves qui l’accompagnent. Rien de plus naturel et nécessaire que de s’endormir.
Une réalité aussi quotidienne que déconcertante, cependant, que l’existence de ce monde à part qui s’insère, comme un régulier intermède, dans la trame de nos jours.
Car rien de plus mystérieux que les rêves, pas de continent plus étrange à explorer, pas de territoire plus infini que cette partie de nous-même. Bien des considérations religieuses, métaphysiques, philosophiques, interrogeant le réel et la vérité, la fausseté et l’illusion, et prenant appui sur le fait des rêves, ont parcouru notre Histoire. Depuis les mythologies grecque ou égyptienne, de Lucrèce à Platon, d’Aristote à Descartes, de Nietzsche à Heidegger, une réflexion sur la veille et le sommeil draine en profondeur l’histoire de la pensée, dans un partage discuté car fondateur entre l’impalpable irréalité des songes contre la vérité du monde. Mais tandis que l’avènement de la philosophie occidentale se conçoit justement comme sortie du sommeil (ignorance, illusion, sommeil de la raison), la pensée orientale, l’hindouisme, voit en le rêve non une plongée dans l’irréalité mais au contraire le début d'une ascension hors de l'illusion du réel, que le sommeil sans rêve (la méditation) poursuit et que le « nirvana », éveil véritable, parachève. Autrement dit, l’état de sommeil et le rêve y sont premiers et fondateurs par rapport à l’état de veille.
Quoiqu’il en soit, il subsiste toujours quelque chose de mystérieux et d’inexplicable dans le fait de ce double monde dans lequel tous nous vivons, une partie ici, l’autre moitié ou presque sur cette « autre rive » toujours aussi étrange que familière.
« Voici donc un rêve. Je vois toute sorte d’objets défiler devant moi ; aucun d’eux n’existe effectivement. Je crois aller et venir, traverser une série d’aventures, alors que je suis couché dans mon lit, bien tranquillement. Je m’écoute parler et j’entends qu’on me répond ; pourtant je suis seul et je ne dis rien. D’où vient l’illusion ? Pourquoi perçoit-on, comme si elles étaient réellement présentes, des personnes et des choses ? », se demande ainsi le philosophe Henri Bergson [3].
Monde parallèle, illusion de l’esprit, réminiscence, construction mentale, résurrection des fantômes invisibles de notre passé comme revenus d’outre-tombe, exécutant, « dans la nuit de l’inconscient, une immense danse macabre »[3] ou encore message symbolique à déchiffrer, message divin (« S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle »[4])[ …Il existe mille et une manière d’interpréter la matière et le sens du rêve. Une profusion d’études, de livres, de théories, qu’une vie entière sans sommeil ne suffirait à connaitre, jusqu’aux neurosciences qui explorent depuis les années 50 les mécanismes organiques et neurologiques mis en œuvre dans les différentes phases de sommeil, là où se nichent et se construisent les songes.
Physique du sommeil…
Ce n’est cependant pas la dimension neurologique du sommeil que nous avons voulu retenir dans « Au-delà de nos rêves », mais ses versants les plus poétiques.
Et avant que de passer de l’autre côté du miroir, c’est d’abord la représentation « physique » du sommeil que nous avons souhaité explorer, au travers de la figure du dormeur, et des « objets » du repos : le lit, l’oreiller, la chemise de nuit…
La représentation de ces objets par les artistes est souvent empruntes d’ambiguïté. L’espace protégé du lit est à la fois celui de nos rêves, du désir et du plaisir, et le lieu des angoisses et du chagrin, notrepremier et dernier lieu de vie. C’est le sens du lit baroque d’Yveline Tropéa (« Ma couche », 2010), hôtel et autel. D’abord symbole d’innocence et de pureté, dans le sommeil et la chasteté, elle en fait aussi le lieu de la trahison, de l’adultère, du mensonge. L’artiste le vit alors comme une « empreinte de mémoire », la rappelant au temps passé, aux espoirs, à la vie, mais aussi à la désillusion, aux amours égarées, à la colère...Dans un esprit proche, l’envolée d’oreillers brodés de Sylvie Kaptur-Gintz (« seules les larmes sont pour l’oreiller », 2012-2013, titre inspiré d’une phrase que l’artiste a souvent entendue dans la bouche de sa mère), manifeste combien la nuit et le lit sont le temps et le lieu des songes, mais aussi ceux, dans le secret de la chambre, des tristesses, des regrets et des souvenirs douloureux. De même, la robe-chemise de nuit emprisonnée dans un dense enchevêtrement de fils noirs de Chiharu Shiota (« State of being #30 », 2010), fantomatique comme la matérialisation d’une vision onirique, empesée comme un vestige, exprime combien le sommeil implique un glissement vers l’inconnu, une perte des repères et de la maîtrise de soi, source d’angoisse chez cette artiste japonaise pour qui le thème est récurrent.
« Dormir, c’est se désintéresser » [3], dit encore Bergson. Pour se laisser glisser dans le sommeil, pour se laisser aller au songe et trouver son nécessaire repos, il faut se détacher des préoccupations de la vie, cesser de vouloir, se sentir en suffisante confiance pour s’abandonner, abandonner le « dehors » pour le « dedans », livrant ainsi sa fragilité, sa vulnérabilité, ici, à nos regards.
En trois intentions différentes, c’est cet abandon et l’effraction de l’artiste dans l’intimité d’un corps endormi qu’appréhendent les œuvres de Mathieu Pernot, de mounir fatmi et de Sophie Calle. Lorsque dans « Les Migrants » (2009), Mathieu Pernot photographie les corps de clandestins afghans, cachés dans des draps, des tissus, des sacs de couchage de fortune, à même un banc ou un carton posé sur le trottoir, il montre cet abandon nécessaire comme un état de pause dans la détresse, mais aussi comme une forme de combat quotidien: trouver où et comment dormir, se cacher, s’abstraire un moment d’un monde qui, dit Mathieu Pernot, « ne veut plus les voir ». « J’ai pensé», écrit l’artiste, « que la meilleure image à faire était celle de leur sommeil, de cet ailleurs que l’on ne connaitra jamais et qui constitue sans doute leur dernière échappée. Je n’ai pas voulu les réveiller. »
Mounir fatmi, réinventant le repos de l’écrivain britannique Salman Rushdie (« Sleep Al Naïm », 2005 – 2012), suggère à son tour l’ambivalence de cet abandon physique, tranquille et intranquille à la fois. Compte-tenu des menaces qui pèsent sur sa vie depuis tant d’années, plonger dans le sommeil reste une manière pour Salman Rushdie de se mettre en état de vulnérabilité. Mais dans le même temps, ce temps d’inconscience accordée exprime force et confiance : le sommeil du juste. Présentée ici dans un contexte apaisé, la vidéo « Sleep Al Naïm» déploie sa dimension autant poétique que politique, et montre le sommeil comme une sorte d’acte de résistance.
Et lorsque Sophie Calle, en 1979, demande à 28 personnes –amis ou inconnus- de venir dormir dans son lit les uns après les autres dans un défilé ininterrompu une semaine durant, il aura bien fallu que ses visiteurs abandonnent toute prudence pour s’abandonner dans un lit étranger, tandis que, confesse-t-elle « Je prenais une photographie toutes les heures. Je regardais dormir mes invités » [5], cherchant peut-être, au travers de cette présence- absence que constitue le spectacle du sommeil de l’autre, à percer le mystère de leur intimité, quand la conscience s’est retirée et que tombent les vigilances…
Voici venu le moment du sommeil. Dans les aquarelles de Katia Bourdarel issues de la série « De l’autre côté » (2008), une jeune fille perdue dans ses songes, à la lisière du sommeil, s’apprête, comme Alice, l’héroïne carrollienne, à traverser le miroir, là où les rêves passent pour réalité et l’envers se fait endroit, à la découverte de soi.
Métaphysique du dormeur
Bien que de nombreux penseurs en aient eu avant lui l’intuition, c’est Freud qui théorisa le premier la signification du rêve comme expression fondamental de cet « invisible topos » qu’est l’inconscient.
Hommage à cette découverte qui, même controversée, reste une étape essentielle de l’histoire humaine dans la connaissance de soi, le diptyque de Robert Longo (Sans titres, Série Freud – Fauteuil, cabinet de consultation 1938 et Oreiller, cabinet de consultation 1938, 2000), évoque dans une atmosphère emprunte de mélancolie, le monde clos du cabinet du Docteur Freud, au 19 Berggasse, à Vienne, en Autriche. Dans cet espace confiné, qui fut chargé de sculptures, de tapis et de tentures, bien des hommes et des femmes vinrent raconter leurs rêves et ici naquit, au détour du 20ème siècle, la certitude que « le rêve est la voie royale d’accès à l’inconscient ». Boîte de Pandore, à l’instar des « Opus » (« Opus I » et « Opus III », 2012) débordants de Vanessa Fanuele, là s’expriment, sans considération de logique et de rationalité, les désirs et les effrois les plus profonds, là se transforme la réalité et se condensent les images.
En quoi l’expression de l’inconscient au travers de sa manifestation qu’est le rêve est-il si précieux à l’inspiration artistique ? Peut-être est-ce parce qu’au-delà du contenu manifeste de son intimité onirique, l’artiste sait mieux que quiconque en transposer le sens. Peut-être est-ce parce que l’artiste est un névropathe.
Un névropathe qui a su tirer le plus digne parti de ses névroses et de ses obsessions, en les traduisant en œuvre ! Ainsi en est-il de tous les artistes dont nous pouvons découvrir les œuvres que nous avons rassemblées, en accrochage serré, sur un « mur de rêves érotiques »…
Mais nous rassure Freud, à la différence du névropathe ordinaire que nous sommes tous, nous retirant chaque nuit dans un monde loin de la réalité, forcément insatisfaisante, l’artiste « s’entend à trouver le chemin du retour et à reprendre pied dans la réalité » en transformant ses rêves, « satisfactions imaginaires de désirs inconscients »[6] en créations esthétiques. Dans un mouvement dialectique, « l’art est un détour par lequel le rêve retrouve le chemin de la réalité » [7] écrit encore le psychanalyste viennois.
C’est cet espace-temps paradoxal et fascinant du rêve, où tout devient possible, où les images font fi du réel et des mots pour les dire, que les artistes peuvent tenter d’appréhender, voire de reproduire, cherchant parfois à « dessiner leur rêve », ou à produire des images de rêve, qui sont parfois cauchemardesques !
Car le rêve, fondamentalement image, se raconte plus difficilement qu’il ne se dessine. Freud encore : « Ainsi la difficulté de raconter un rêve vient-elle en partie de ce que nous avons à traduire des images en paroles. Je pourrais vous dessiner mon rêve, dit souvent le rêveur, mais je ne saurais le raconter."[8]. Il semble dès lors évident que l’artiste, dont le travail consiste précisément en la production, la construction, la manipulation d’images, soit le premier concerné et le premier touché par la question du rêve, nourrissant son énergie créatrice en puisant aux puissantes fantasmagories du rêve. Si la remarque est valide pour la littérature, la poésie, le théâtre, et pour le cinéma, dont l’analogie avec le rêve se fit jour dès sa naissance ou presque, ce qui explique, pour certains théoriciens du cinéma, le succès du cinéma sur tous les autres arts comme puissance hypnotique –puissance qui fera dire au grand critique Serge Daney : «il y a des films que nous ne sommes pas sûrs de ne pas avoir rêvé »[9] -, elle l’est aussi et de pleine légitimité pour les arts plastiques et pour l’art contemporain.
Au sens premier, cela donne, par exemple, la reconstruction d’une image onirique chez Pilar du Breuil (« Quiosco », 2010), proprement expression de ses désirs d’enfant. Ou encore, avec le couple de dormeurs d’Hervé Ic (Série « Les dormeurs », 2013), la tentative de matérialiser sur la toile la matière confuse du rêve. Dans l’installation « Conversation secrète » (2013), Clémentine de Chabaneix nous invite à observer, comme par effraction, par l’œilleton d’une boîte, une scène nocturne, évoquant avec justesse et poésie le dédoublement du corps et de l’esprit pendant le moment du rêve : « Le corps et l’esprit ne se consultent plus ou peu, mais restent menottés l’un à l’autre. » avance-t-elle. Autour de la dormeuse, lévitant au-dessus de son lit, des images apparaissent et s’évanouissent comme des ombres. Ces images, comme les idées pendant le rêve, ne sont pas reliées entre elles. Elles se suivent, se conjuguent ou se contredisent et forment un langage que ni le corps ni la conscience ne contestent.
Et puis, il y a cette expérience particulière, réalisée par la violoniste Sayaka Shoji et le vidéaste Pascal Frament. Avec « Synesthesia » (vidéo, 2008), nous assistons à une sorte de « rêve éveillé », sorte de puzzle mental qui n’est autre que celui de la jeune violoniste japonais lorsqu’elle joue sur son Récamier, un Stradivarius de 1729. Que les images prennent racine dans la musique et la portent semble particulièrement intéressant dans cette réflexion sur la manière dont les artistes arrachent les images du fond de leur intimité onirique pour les émerger à la surface de la réalité. Il semblerait que ce travail d’émersion s’accompagne d’un acte de complétude : alors l’œuvre d’art devient « réalité augmentée ». D’une certaine manière, l’artiste « achève » dans son acte créatif la part manquante du rêve. Celle qu’évoque Adorno: « Lorsqu’on s’éveille au milieu d’un rêve, même du pire cauchemar, on est déçu et l’on a l’impression d’avoir été frustré de la meilleure part.(…) Même le rêve le plus beau porte comme une tache sa différence par rapport à la réalité, la conscience de ne nous procurer que de simples illusions. Voilà pourquoi les rêves les plus beaux ont comme une fêlure. » [10]. De là peut-on appréhender le lien dialectique qui unit le rêve de l’artiste à son élan créateur. L’œuvre d’art ne serait pas seulement une manière privilégiée de ramener à la surface du réel le résidu d’un rêve mais une opération par laquelle l’artiste augmente, enrichit, la dimension purement onirique en la matérialisant. Pour paraphraser la célèbre assertion de Robert Filliou, « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », on serait tenté de dire : « le rêve est ce qui rend l’art plus intéressant que le rêve » !
De manière plus figurée, avec une belle charge poétique et un certain sens de l’humour, les « plans sur la comète » (2006-2013) de Emmanuel Régentexpriment aussi la métamorphose délicate du rêve en réalité artistique, ou comment l’artiste tente, et parfois échoue, à matérialiser ses rêves. Peut-être ces grandes feuilles de papier blanc roulées, prenant leur élan depuis une petite corbeille à papier, tout à fait ordinaire, cachent-elles sur leur endroit, qu’on ne voit pas, quelque esquisse fabuleuse…ou peut-être rien. Avec la subtilité qui caractérise son travail, Emmanuel Régent produit ici des espaces de spéculation, surfaces de tous les possibles, suggérant aussi combien la part de projection imaginaire, la même que celle qui est à l’œuvre dans le rêve, combien les « actes manqués », sont au cœur de la démarche artistique.
Poétique du rêve
Du sommeil de l’artiste, produisant ses rêves, à l’acte créateur, il n’y a peut-être donc qu’un pas, un glissement… Le rêve se déploie comme espace poétique, au sens étymologique propre, « poiêsis », espace de création.
Le domaine de la création artistique, même si le contenu de celui-ci n’est pas directement inspiré d’univers oniriques, peut aisément se lier au domaine intime, et à la mécanique, du rêve. Soit que l’artiste, comme le suppose la théorie freudienne, puise dans ces strates obscures de quoi nourrir sa créativité. Soit que d’une manière plus générale, on puisse élaborer des analogies entre le processus imaginaire à l’œuvre dans la production artistique et ce qui se joue dans nos visions oniriques : perturbations alogiques, spatiales ou temporelles, enchevêtrements des registres visuels, ambivalences des émotions, condensation des représentations, symbolismes, intrusions…
Pour « Au-delà de mes rêves », nous avons choisi des œuvres retentissant directement avec cette hypothèse analogique des œuvres dont la genèse, le sujet, ou la présence dans l’espace d’exposition, sont peu ou prou en prise directe avec les possibles rhizomiques du rêve.
On retrouve ainsi nombre de ces éléments mêlés dans « Garden, sweet garden » (2012-2013), l’œuvre imaginée pour le Monastère par Mai Tabakian. Fleurs dévorantes et champignons vénéneux ? Visions hallucinatoires ? Plantes psychotropes ? Confiseries géantes de chez Willy Wonka ? Métaphores sexuelles pour rêves de jeunes filles, délice freudien ? Un bien étrange jardin, semblant tout droit sorti d’un rêve à la lisière du cauchemar, rassemblant trois séries d’œuvres en prolifération, et ouvrant à une multiplicité, une superposition d’interprétations.
Ainsi aussi des objets fantasmatiques de Corine Borgnet. Dans le déroulement du rêve, il n’est pas rare que des éléments incongrus ou irrationnels fassent intrusion dans la narration sans que l’esprit assoupi ne s’en émeuve. Les petites sculptures en résine et silicone de Corine Borgnet procèdent de cette effraction insolite et surréaliste, comme autant de petites perturbations dans le décor. La main d’un ogre couvert de terre, ou un outil rongé de racines abandonné là, par quelque inquiétante créature peut-être, errant la nuit parmi les cloîtres du Monastère…D’étranges objets, tout droits sortis d’un film de Lynch ou de Burton, ou de n’importe quel cauchemar dans lequel, glissement fantasmatique, plus rien n’étonnerait malgré l’effroi.
Ainsi également des installations de Jamila Lamrani, deux espaces clos conçus comme de « petits cabinets de curiosité ». L’artiste y installe son univers, deux univers parallèles, « entre deux rêves ». On y retrouve une atmosphère onirique, délicate et mystérieuse propre à la plupart de ses travaux. « Entre deux rêves » (2013) se dessine donc comme une tentative de dresser deux territoires, la « reproduction » de deux visions fictives, un essai pour enfermer ces restes, ces fragments, ces bribes de rêves, dans un espace poétique réel … Avec une certaine économie de moyens (elle use de matériaux « simples, ordinaires, fragiles », à la réception sensible et immédiate : fils de laine, voiles de gaze, papier de soie coton…), Jamila Lamrani sait créer des œuvres qui « disent ce rapport au réel qui existe même dans les limbes embrumées de nos rêves » [11].
Plus loin encore, chez Yayoi Kusama, les fleurs multicolores, et couvertes de pois, motif récurrent dans l’œuvre de l’artiste japonaise, se font l’expression visuelle obsessionnelle de ses hallucinations. Cette forme hallucinatoire constitue « la première forme de son alphabet et sa marque de fabrique » [12] mais s’envisage finalement davantage comme forme symbolique que comme « outil visuel ». Les « Tulipes de Shangri-la » (2003) sont nourries de multiples sens: réellement au-delà des rêves, dans leur dimension hallucinatoire, elles expriment, et notamment en ce qu’elles ont d’exemplaire dans l’œuvre de Kusama, la quintessence de la puissance du rêve et de l’inconscient à l’œuvre dans le processus de création artistique.
Yayoi Kusama, comme d’autres artistes présents dans l’exposition – dont, par exemple, Christian Lhopital (« Opening night », 2008) – répond parfaitement à la définition que Nietzsche fait de l’artiste : à la différence de l’homme ordinaire, qui s’ingénie à ignorer ses rêves, l’artiste est un rêveur qui « sait » qu’il rêve.
Sa liberté, et sa force, résident alors dans sa capacité à s’en approprier le contenu, à le reconnaitre comme sien, et à en faire le terreau fertile de son œuvre.
« Rien ne vous est plus propre que vos rêves ! Rien n’est davantage votre oeuvre ! » [13]
Le grand sommeil
« Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l’image de la mort ; un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l’instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l’œuvre de l’existence. C’est un souterrain vague qui s’éclaire peu à peu, et où se dégagent de l’ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres : - le monde des Esprits s’ouvre pour nous. »
Gérard de Nerval – Aurélia, 1853
S’endormir, quitter son corps physique, le laisser inerte, pour pénétrer d’autres mondes… Les liens sont ténus entre le moment de sombrer dans le sommeil et celui de plonger dans les dernières ténèbres. De nombreuses religions considèrent d’ailleurs que le sommeil et la mort sont les deux représentations d’un même état, le sommeil étant une forme de mort dont nous ressuscitons chaque matin par la grâce divine, tandis que la mort n'est qu'une étape, un sommeil dont on s'éveillera dans un monde meilleur.
Il n’est pas rare que les expressions culturelles, artistiques, ou linguistiques liées au sommeil et/ou à la mort expriment cette ambivalence : éternel repos, grand sommeil, ou encore la figure du « gisant », que l’on retrouve aussi, d’une certaine manière, dans la vidéo de mounir fatmi, les photographies de Mathieu Pernot, dans lesquelles le doute, subrepticement, s’immisce, ou encore dans le sublime « lit végétal » de Monica Mariniello, que l’on pourrait tantôt interpréter comme lit de conte de fées, tantôt comme le somptueux décor d’un dernier repos.
Le Monastère Royal de Brou ayant une vocation funéraire (y sont déposés, en de somptueux tombeaux, les dépouilles de Marguerite d’Autriche duchesse de Savoie et de son époux Philibert II le beau), nous avons voulu explorer l’ambivalence de cette représentation. L’analyse de certaines œuvres révèle ainsi une proximité entre ces territoires connexes.
Les « Pillows for the dead » de l’artiste japonaise Rei Naito, trois œuvres minuscules, légères comme un souffle, délicatement cousus dans un organza de soie opalescent à la fois irréel et précieux, fragile et délicat, évoquent le dernier voyage et le repos des morts. Trois petites choses mystérieuses et si délicates que seul un ange pourrait y déposer la tête sans les écraser.
« The dream of the mariners’s daughter », de Clémentine de Chabaneix, semble avoir échoué au beau milieu des salles capitulaires du Monastère, dans un sillage de feuilles mortes venues de l’automne, de retour d’un long voyage…Ou bien cette précaire embarcation est un véhicule vers un au-delà ? Que l’on s’en rapproche, que l’on s’y penche, et on y découvre tout un monde intérieur, bribes de souvenirs, images du passé, peut-être imaginaires. Ce bateau, sur lequel se tient un arbre en péril, exprime, dans l’ambiguïté de son état, la force de résistance de la vie contre l’oubli et la mort, dans la traversée du dernier fleuve, Styx ou Léthé. Sur l’autre rive, la métamorphose, le renouveau, la jeunesse et les rêves.
Les petits personnages de Jean-Marc Forax nous apparaissent comme de bienheureux bébés repus et assoupis. Mais en réalité, il s’agit du visage poupin de Jizō, protecteur des âmes mais surtout compagnon des enfants morts, « injustement punis dans les mondes souterrains »[14]. Dans la mythologie japonaise, Jizō aide les enfants morts à traverser le fleuve divin Sanzu, eux qui n’ont pas assez vécu pour pouvoir atteindre seuls l’autre rive. La coutume veut que les mères ayant perdu un enfant confectionnent un bavoir rouge et l'accrochent à une statue de Jizō, protégeant de cette manière l'enfant défunt du froid dans son voyage vers l'au-delà.
La nuit et le froid, s’ils invitent à l’hibernation, nous conduisent, par analogie avec la vie naturelle, vers un imaginaire morbide. Tel est le message de « L’annonciateur du froid », un des sept « Messagers de la Mort décapités » (2006), de l’artiste anversois Jan Fabre. Symbole dans de nombreuses cultures, en Chine, en Grèce ou en Egypte, la chouette, ou le hibou, au cycle de vie inversé, s’inscrit également dans la tradition de l’art flamand. L’oiseau nocturne et messager, évoquant la sagesse et la folie, la persistance de la vie et la mort, hante les tableaux de Bosch ou de Bruegel. Celui de Jan Fabre, hypnotisant, semble nous inviter à le suivre dans quelque passage initiatique et funèbre. « Tout ce que je fais est une célébration de la mort, comprise comme quelque chose de positif. La mort », affirme Jan Fabre, « te tient éveillé » [15].
Jusque dans le rêve se tenir éveillé.
Bibliographie :
[1]Baudelaire - Œuvres posthumes 1908, « Mon cœur mis à nu », 1867
[2]Quentin Bajac – « Reconstitutions » - Ed. Philléas Fogg, 2003
[3] Henri Bergson – « Le rêve » in « L’énergie spirituelle », Essais et conférences, 1919 – PUF
[4]Livre des Nombres, 12.6
[5] Sophie Calle, Conférence donnée le 15 novembre 1999 à l’université de Keio, Tokyo
[6]Sigmund Freud, « Ma vie et la psychanalyse », 1925, trad. M. Bonaparte, Éd. Gallimard,1968, pp. 79-81
[7]Sigmund Freud, « 5 leçons de psychanalyse », 1910 - Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", nouv. Éd., 2010
[8]Sigmund Freud – « Introduction à la psychanalyse », 1917 – trad. S. Jankélévitch, Ed. Payot, 1922
[9]Serge Daney – « Ciné-journal », Paris, cahiers du cinéma, 1984
[10] T. W. Adorno – « Minima Moralia : réflexions sur la vie mutilée », 1951, Ed. Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2003
[11] d’après un texte de Bernard Collet sur Jamila Lamrani, janvier 2011
[12] Eric Troncy – “Yayoi Kusama” – Ed. Presse du Réel, 2001